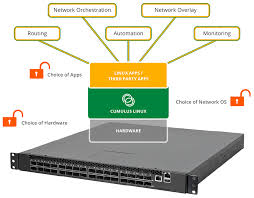Musique : après les pirates, la RIAA chasse les auteurs
Face à la chute soi-disant vertigineuse de ses bénéfices, l'industrie de l'édition musicale cherche par tous les moyens de conserver son train de vie. Rappelons que la première réaction de ces marchands a été de jeter la responsabilité des pertes de bénéfices sur le dos d'Internet, de l'informatique en général, et de tout l'appareil productif du secteur des TIC. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de ce mois, certains disques durs externes sont surtaxés pour compense le manque à gagner provoqué par la copie numérique d'un CD de musique légalement acheté sachant accessoirement que cette copie est considérée comme désormais quasiment interdite (ouf). Merdre Mère Ubu ! Nous avons tellement décervelés ces polonais que leurs oneilles ne leur serviront plus à rien et qu'ils abreuveront sans piper notre pompe à phynance ! Cornegidouille, de part ma chandelle verte, ce plan est extraordinairement et vicieusement récursif. Ces rentes de situation, allant de la dime sur les supports vierges à la gabelle sur les lecteurs MP3, accompagnés de programmes d'espionnage et autres outils frisant l'abus de bien privé, ne suffisent hélas pas à redresser une machine qui croule sous son propre poids de fonctionnement. Lorsque les « pirates » ne rapportent plus, il ne reste plus qu'une victime à saigner : l'auteur de l'oeuvre. Déjà, certaines majors tentent d'imposer aux artistes des « contrats globaux », autrement dit une prise de commission obligatoire non plus sur les ventes de disques, mais également sur les concerts, produits dérivés etc. Sous prétexte probablement que le « disque » et sa diffusion ne sont qu'une forme d'effort promotionnel destiné à mieux faire vendre les concerts et l'artiste ? Certaines formations refusent énergiquement, d'autres se mordent les doigts d'avoir défendu avec acharnement hier les exigences de ceux qui les ponctionnent encore plus lourdement aujourd'hui. D'autant plus que de plus en plus de musiciens vivent essentiellement grâce à leurs spectacles, la vente d'enregistrements devenant quantité négligeable dans le bilan comptable. Autre trouvaille de la RIAA, ainsi le rapporte Hollywood Reporter, il suffirait de faire passer de 9 à 8% les droits concédés aux auteurs et éditeurs dont les oeuvres seraient diffusées de manière électronique. Certains diffuseurs, tel Apple, sont encore plus généreux, et pense que 4% devrait amplement suffire, sous prétexte « qu'il ne faut pas tuer la poule aux oeufs d'or, car en étant trop gourmand, l'on joue en faveur de tarifs trop élevés, et l'on encourage ainsi le piratage ». Car concéder à un auteur 4% de la valeur de son travail, ce n'est ni du vol, ni du piratage, ni de l'abus de position dominante, ni du racket, ni de l'intimidation. Peu à peu, l'industrie de la diffusion musicale calque ses schémas de fonctionnement sur ceux de la grande distribution : grandes surfaces de la vente de disque, prix d'appel, tarifs concurrentiels imposés et marges aux producteurs calculées en conséquence,... on en arriverait presque à se demander si l'idée de développer l'idée des « marges arrières » ne seraient pas en train de faire son chemin. Face à cette normalisation du marché par les circuits de distribution, la demande s'adapte, formate de plus en plus ses « produits » -ne parlons plus d'oeuvre - pour répondre à une demande totalement fabriquée et correspondre aux contraintes de rentabilité et de production. Au grand dam des petits producteurs « bio » et des artisans, ceux qui téléphone au moins une fois par semaine à Mesdames Calliope, Erato ou Euterpe, fournisseuses officielles d'Art Lyrique vrac. Cette industrialisation est-elle une réponse efficace contre le piratage ? Rien n'est moins sur. Car en confondant l'Art et le merchandising, l'industrie du disque a assimilé ses productions à une denrée de consommation, jetable après usage, à faible durée de vie, et par conséquent d'une valeur marchande toute aussi faible. La différence entre la valeur « constatée » de ce qui est vendu et le « gratuit » du piratage est de plus en plus insaisissable dans l'inconscient collectif. Cette dérive a un nom : paupérisation. Las, il ne peut pas plus exister de « musique gratuite » qu'il ne peut vivre de « presse gratuite ». Toute production intellectuelle de qualité possède une valeur marchande intrinsèque qu'il ne faut absolument pas confondre avec son médium, son moyen de diffusion. Si ce médium prend le pas sur son contenu, si l'enjeu ne consiste plus qu'à vendre le contenant en utilisant sa substantifique moelle comme simple alibi, alors la survie du système tout entière est compromise. Et l'ajout de nouvelles béquilles financières, de prothèses policières et juridiques, d'ossatures faites de taxes, pensions et rentes ne feront que retarder l'agonie imminente dudit système.